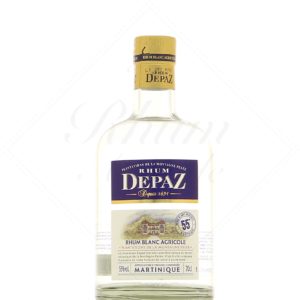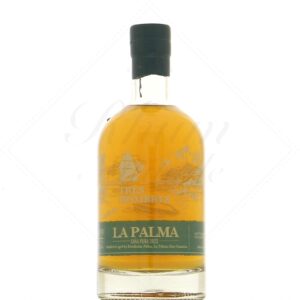Qu’est-ce que le rhum agricole ?
Définition et origine du rhum agricole
Le rhum agricole a une définition assez simple en principe : c’est un rhum qui est produit à partir du pur jus de canne. Vous découvrirez quelques subtilités un peu plus loin, dans la partie réglementation 😉
C’est une appellation limitée aux départements français d’outre-mer et à Madère, ce qui nous amène directement à ses origines. En effet, pourquoi limiter cette appellation à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, et surtout pourquoi Madère se retrouve dans cette liste ? Eh bien il se trouve que ces territoires partagent la même histoire autour du sucre et du rhum, et ont vécu le même tournant qui a vu naître le rhum agricole tel que l’on le connait aujourd’hui.
À la fin du XIXème siècle, une sévère crise sucrière sévit dans le monde entier. L’industrie peine à se réinventer depuis l’abolition de l’esclavage, le sucre de betterave impose une concurrence féroce, et les rendements diminuent en raison l’épuisement des sols trop longtemps voués à la monoculture de la canne.
En conséquence, la production se concentre, beaucoup de petites usines / distilleries ferment leurs portes et les grandes usines centrales apparaissent. Les petits planteurs, loin des usines et isolés, se retrouvent avec leur production sur les bras. Ils vont alors se mettre à distiller directement leur jus de canne pour faire du rhum, sans passer par l’étape du sucre et de la mélasse. Aux Antilles Françaises, on appelle cela le « rhum z’habitant », qui deviendra plus tard le rhum agricole et qui gagnera peu à peu ses lettres de noblesse.
Processus de fabrication du rhum agricole
Le rhum agricole est une eau-de-vie de pur jus de canne à sucre. La canne est coupée à la main ou avec des machines, selon le souhait et les possibilités du cultivateur et/ou du relief. Pour obtenir un maximum de rendement (en sucre et donc en alcool), la canne est broyée et son jus mis en fermentation au plus vite. Lorsqu’elle est coupée à la main, elle est souvent pressée telle quelle, mais lorsque la récolte est mécanisée, les distilleries préfèrent la rincer afin de se débarrasser du plus gros des impuretés. Le fait d’arroser la canne pendant son broyage permet également de l’imbiber d’eau, afin de favoriser l’extraction de jus. Les techniques de broyage vont du simple moulin actionné à la main, au moulin plus industriel où la canne arrive coupée en tronçons et passe par une batterie de 4 ou 5 broyeurs.
Le jus pressé est ensuite envoyé en fermentation, l’étape où le sucre est transformé en alcool par l’action des levures. Là aussi, les méthodes sont multiples et impliquent plus ou moins de contrôle. Selon le profil de rhum recherché, l’on va varier l’apport de levures « sauvages » et de levures de culture, la durée de la fermentation, la température des cuves, etc. Lorsque la fermentation terminée, le plus souvent après 24 à 48 heures, l’on obtient un vin de canne qui titre souvent entre 4 et 8% d’alcool, prêt à distiller.
La distillation permet de concentrer l’alcool, tout en triant et en sélectionnant les éléments que l’on souhaite conserver dans le rhum, selon la température à laquelle ces éléments s’évaporent dans l’alambic.
Pour cela, le distillateur utilise une colonne (comme la fameuse colonne créole) ou un alambic traditionnel. Ce dernier permet de chauffer le vin de canne, de récupérer ses vapeurs alcoolisées et aromatiques et de les condenser pour leur faire retrouver un état liquide. On vide ensuite l’alambic du liquide épuisé en alcool (les « vinasses »), et on recommence. La colonne permet de distiller en continu, en l’alimentant en jus de canne fermenté depuis le sommet. À sa base, l’on injecte de la vapeur, cette vapeur ascendante venant rencontrer le jus qui descend, freiné par des plateaux. La rencontre de ces deux éléments volatilise l’alcool et les composés aromatiques, qui retrouvent ensuite un état liquide après condensation.
Après la distillation, le rhum obtenu est translucide. On le laisse reposer quelques semaines, voire quelques mois (le plus long est le mieux), tout en le diluant progressivement pour atteindre le degré d’alcool voulu. Il peut ensuite être mis en bouteille comme rhum blanc. Le repos peut bien sûr être prolongé en fût, et le rhum se parera d’une robe ambrée au contact du bois. Il deviendra alors rhum ambré ou rhum vieux.
Caractéristiques et saveurs du rhum agricole
La principale caractéristique du rhum agricole est son caractère végétal, herbacé, très proche de sa matière première qu’est le jus de canne à sucre. On retrouve également de manière assez typique des arômes poivrés et des notes d’agrumes. Ensuite, tout un éventail peut se déployer, avec une canne plus ou moins mûre, plus ou moins sèche, qui développe des nuances plus fruitées, iodées, terreuses, épicées…
Qu’est-ce que le rhum industriel ?
Définition et origine du rhum industriel
Le rhum industriel est élaboré à partir d’un produit dérivé de l’industrie du sucre, la mélasse, d’où son nom. Cela ne signifie pas nécessairement que ce rhum est issu d’un procédé industriel au sens production à grande échelle. En effet, le rhum industriel peut tout à fait être un produit artisanal, issu de mélasse industrielle mais élaboré par une petite distillerie.
Ainsi, le terme rhum industriel n’est pas, et ne devrait pas être un gros mot, d’autant qu’il existe autant d’excellent produits dans cette catégorie que dans celle du rhum agricole. Statistiquement, et pour être un brin provocateur, il en existe même sans doute davantage, le rhum industriel représentant environ 90% de la production mondiale !
Petite nuance dans ce monde du rhum industriel / rhum de mélasse : le rhum de sucrerie, qui est issu d’une usine qui produit à la fois son sucre et son rhum. On peut par exemple penser au Galion, en Martinique, ou à Worthy Park en Jamaïque.
Processus de fabrication du rhum industriel
Le rhum industriel est obtenu à partir de la mélasse, un sous-produit de la fabrication du sucre. La canne est récoltée, broyée, et son jus est cuit pour évaporer l’eau et ainsi concentrer le sucre. Durant cette dernière étape, on ensemence la préparation de quelques cristaux de sucre, auxquels le sucre en cuisson vient s’agglomérer. À l’issue de cette cuisson, on passe l’ensemble à la centrifugeuse pour séparer le sucre cristallisé du jus de canne cuit et appauvri en sucre que l’on appelle la mélasse. Cette opération de cuisson / séparation peut être répétée plusieurs fois, jusqu’à obtenir un sucre très raffiné et une mélasse très pauvre.
Même si la mélasse est épuisée en sucre cristallisable, elle contient toujours du sucre que l’on peut fermenter afin de produire de l’alcool. Elle est moins aromatique et contient plus d’impuretés qu’une mélasse moins raffinée, mais elle est plus économique. Les distilleries font ensuite le choix du type de mélasse qui leur convient, selon leurs contraintes et leurs objectifs.
Avant d’être mise en fermentation, la mélasse est diluée avec de l’eau pour atteindre un taux de sucre et une viscosité adéquats. L’on peut également utiliser des vinasses pour cette dilution, afin de maximiser l’acidité et de favoriser ainsi la création d’arômes. La suite se déroule comme pour le rhum agricole, avec une mélasse de canne que l’on fermente, distille et que l’on met éventuellement en vieillissement.
Caractéristiques et saveurs du rhum industriel
Il n’est pas facile de définir les caractéristiques d’un rhum industriel, tant l’éventail des arômes et saveurs possibles est large. L’on pourrait éventuellement dire qu’à la différence du rhum agricole, il n’est pas forcément herbacé, mais des exceptions pourraient très certainement démentir cette affirmation.
Le rhum industriel peut être de type léger, avec des arômes discrets, plutôt floraux et épicés. Il peut aussi être traditionnel, et comporter quelques arômes réglissés issus d’une mélasse encore bien riche. S’il est de type grand arôme, on y retrouvera des notes de fruits tropicaux très mûrs, de saumure d’olive, souvent associées à une touche de solvant.
Rhum agricole vs rhum industriel : quelles sont les différences ?
Matière première utilisée
C’est le plus important à retenir :
Rhum agricole = pur jus de canne
Rhum industriel = mélasse
Ensuite, pour ce qui est du meilleur rhum, c’est à votre palais de décider !
Processus de fermentation et de distillation
Les procédés de fermentation et de distillation du rhum agricole et du rhum industriel sont plus semblables que ce que l’on pourrait imaginer. Les règles de base sont les mêmes : production d’alcool à partir du sucre, puis concentration et sélection des composés aromatiques.
De plus en plus de distilleries se mettent d’ailleurs à produire les deux types de rhums, à l’image de Savanna qui le fait déjà depuis très longtemps à La Réunion. Dans la Caraïbe, la mélasse se faisant de plus en plus rare, de nombreuses distilleries voient un avenir passant par le pur jus de canne. Les îles comme la Barbade, la Jamaïque ou Ste Lucie n’entrent en revanche pas dans l’appellation « rhum agricole », mais peuvent produire un rhum de pur jus de canne qui s’en approche.
Terroir et influence du climat
Le rhum étant un produit distillé, le facteur terroir est moins évident et moins direct que dans l’univers du vin. Néanmoins, il a été mis en évidence que le sol (bien plus que la variété de canne) avait bien un réel impact sur le rhum agricole. Selon la nature du sol, son exposition, son humidité, la canne se gorge de nutriments et de soleil de la même manière qu’un grain de raisin. Ces qualités se retranscrivent donc logiquement dans le pur jus qui est ensuite distillé.
Elément de terroir à mettre au crédit du rhum industriel : l’eau de dilution de la mélasse. Puisqu’il est nécessaire de diluer la mélasse avec de l’eau avec un ratio de 1 pour 6 ou 7, cet élément devient crucial, et sa pureté devient centrale.
Mais peut-être est-ce lors de la fermentation que l’effet terroir se manifeste réellement, et dans ce cas, le rhum agricole et le rhum industriel se retrouvent à armes égales. Les levures et bactéries naturellement présentes dans l’environnement de la distillerie influencent énormément le vin de canne qui va être distillé. Ces micro-organismes sont si importants qu’un changement minime au sein de l’écosystème d’une salle de fermentation peut tout bouleverser dans le profil aromatique d’un produit.
Goût et profils aromatiques
L’on pourrait croire que certains marqueurs aromatiques sont exclusivement réservés à un type de rhum, pourtant de nombreux exemples viennent contredire les règles. Il vous suffit de déguster un Ron Barcelo issu de pur jus de canne et extrêmement léger, comme un rhum cubain de mélasse, et un Mhoba d’Afrique du Sud, toujours en pur jus de canne, avec des arômes ultra-funky façon high ester jamaïcain.
Réglementations et appellations
Dans la réglementation européenne, la définition du rhum agricole est plutôt simple, mais cette simplicité implique quelques subtilités. Le point central, celui qu’il faut retenir avant tout, est que le rhum agricole doit être produit à partir du pur jus de canne à sucre.
Parmi les détails qui ont en réalité toute leur importance, le rhum agricole doit également répondre aux critères du rhum traditionnel. C’est-à-dire qu’il doit avoir été distillé en dessous des 90% d’alcool (contre 96% maximum pour les autres rhums), à partir de matière première locale, doit contenir une quantité de substances volatiles (molécules responsables des arômes) supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur, et ne peut pas être édulcoré.
Tout ceci est assez technique, mais globalement, l’on veut s’assurer que le rhum soit bien produit à partir de matière première locale, et qu’il soit suffisamment aromatique et caractéristique du rhum.
Comme nous l’avons vu, le terme rhum industriel pose une petite difficulté lexicale qui est à l’origine d’un grand malentendu : les producteurs de rhum industriel (que l’on peut aussi appeler rhum de mélasse) se sont en quelque sorte approprié le terme « rhum traditionnel », qui serait opposé au rhum agricole. L’on peut les comprendre, car le terme est nettement plus vendeur ; or, pour rappel, le terme rhum traditionnel s’applique à un rhum issu de matière première locale, distillé à moins de 90%, contenant plus de 225g/hlap de composés volatils, et non sucré. Ce rhum traditionnel peut donc aussi bien être de mélasse que de pur jus.
Pour ajouter à la confusion, le terme traditionnel est même souvent employé de manière trompeuse pour des rhums de mélasse légers, donc très peu aromatiques, et parfois même sucrés.
Quel rhum choisir selon vos préférences ?
Pour les amateurs de saveurs authentiques et complexes
Ce rhum blanc de Martinique est l’un des chouchous de l’équipe, c’est un saisissant instantané de terroir Martiniquais.
Cet embouteillage de rhum de Trinidad montre l’étendue d’arômes que le rhum industriel est capable de proposer.
Un bel exemple d’authenticité et de terroir, pour ce rhum jamaïcain explosif.
Pour les cocktails et les mélanges
Hors agricole, mais un cousin à découvrir, cet assemblage de clairins haïtiens est un concentré de terroir. Ultra-typique du pur jus de canne élaboré de façon traditionnelle.
Nouvel assemblage, cette fois de rhums de mélasse, avec un équilibre subtil entre élégance et folie.
Une merveille de l’île de Grenade, entre agricole et industriel, élaboré à partir de sirop de canne.
Impact écologique et production responsable
52,5 : Une superbe eau-de-vie de canne, un rhum agricole Bio de haute couture
La délicatesse du pur jus de canne Bio vieilli, transporté à bord d’un voilier
Bologne est la première exploitation agricole de Guadeloupe à être certifié HVE (Haute Valeur Environnementale), elle l’illustre avec ce délicieux L’Ethique Bio.